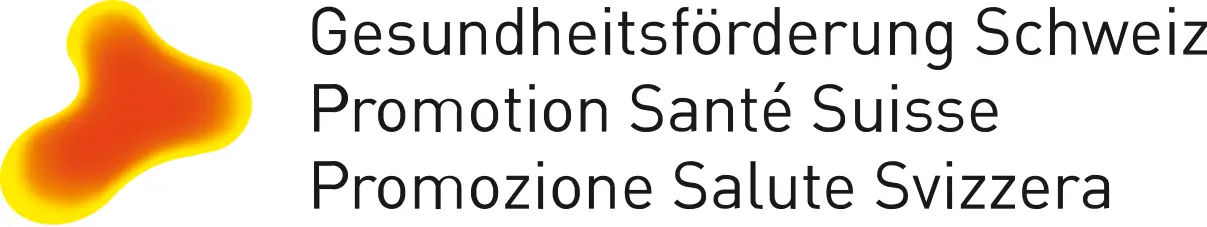Monitoring de l’IMC chez les enfants et les adolescent-e-s en Suisse

Le présent dossier passe en revue les principaux résultats, les classifications et les questions les plus fréquentes. Il fournit par ailleurs des recommandations pour une communication différenciée et respectueuse sur la thématique.
FAQ
Qu’est-ce que le monitoring de l’IMC?
Promotion Santé Suisse collecte périodiquement des données sur le poids des élèves en Suisse par le biais de deux études complémentaires.
Depuis l’année scolaire 2005/2006, l’analyse annuelle des données des services médicaux scolaires des villes de Bâle, Berne et Zurich permet d’étudier la prévalence et l’évolution du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescent-e-s des agglomérations urbaines.
En complément, Promotion Santé Suisse effectue tous les quatre ans une étude comparative de l’IMC qui intègre des données provenant d’autres cantons et villes en sus de celles mentionnées. Il est ainsi possible de dresser un vaste tableau de la situation en Suisse. Jusqu’à présent, ces études ont été réalisées en 2010, 2013, 2017, 2021 et 2025.
Le monitoring de l’IMC compare les différents niveaux scolaires entre eux, du 1er au 3e cycle. L’objectif est d’identifier les variations dans la prévalence du surpoids et de l’obésité au fil du temps et entre les régions afin d’en tirer des informations utiles pour le développement de mesures ciblées en matière de promotion de la santé et de prévention.
Synthèse des principaux résultats de 2025
Dans le cadre du dernier monitoring comparatif de l’IMC, les données de plus de 30 000 élèves de onze cantons et de quatre villes ont été recueillies et analysées.
- Les données ont été collectées dans les cantons d’Argovie, Bâle-Ville, Grisons, Jura, Lucerne, Obwald, Saint-Gall, Schwyz, Uri, Vaud et Zurich ainsi que dans les villes de Berne, Fribourg, Winterthur et Zurich.
- Au niveau du 1er cycle, on constate un net recul de la proportion d’enfants en surpoids, qui est passée de 15,8% en 2010 à 11,1% en 2025.
- Au niveau du 2e cycle, cette proportion a d’abord diminué entre 2010 (19,1%) et 2017 (16,5%) avant de remonter à 18,6%.
- Au niveau du 3e cycle, si la proportion stagne depuis 2010 (2010 : 20,5% ; 2025 : 20,9%), de premiers signes d’amélioration se dessinent.
- La prévalence du surpoids augmente non seulement avec le niveau scolaire, mais varie aussi considérablement entre les cantons et les villes. Toutefois, contrairement aux monitorings précédents, aucune différence claire entre les zones urbaines et rurales n’a pu être mise en évidence en 2025.
- Le sexe ne joue guère de rôle, tandis que l’origine sociale et la nationalité influencent significativement le poids corporel. L’origine sociale, en particulier, constitue un facteur de risque important pour le surpoids, dont l’influence a encore progressé depuis le monitoring de 2021.
- Par rapport au premier monitoring réalisé en 2010, on observe une baisse de 1,3% de la prévalence totale dans les écoles obligatoires. Compte tenu des moyens limités consacrés à la prévention du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescent-e-s et de la tendance à la hausse observée au niveau international, ce résultat peut être considéré comme positif.
Pourquoi Promotion Santé Suisse réalise-t-elle ce monitoring?
Le monitoring de l’IMC sert à étudier systématiquement l’évolution du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescent-e-s en Suisse, en opérant une distinction par niveau scolaire, région, sexe et origine sociale. Le monitoring crée une base de données solide permettant d’identifier les tendances et de comprendre les évolutions. Il s’agit d’un outil important pour Promotion Santé Suisse, qui permet de distinguer les groupes cibles vulnérables et les domaines dans lesquels les mesures de prévention présentent le plus grand potentiel d’impact. Le monitoring rend également plus visibles les différences sociales dans la répartition du surpoids et met en évidence la nécessité d’agir au niveau structurel.
Le monitoring soutient ainsi l’orientation stratégique des activités de promotion de la santé – en particulier des programmes d’action cantonaux (PAC) – et donne des impulsions importantes au monde professionnel, à la politique et à la société. Il contribue également à la mise en œuvre de la stratégie nationale Prévention des maladies non transmissibles et renforce la qualité et l’efficacité de la promotion de la santé à long terme.
Limites de l’IMC et de son système de classification
L’IMC est un indicateur simple qui reflète le rapport entre le poids et la taille. Il est utilisé à l’échelle internationale pour classer le poids corporel dans des catégories telles que « poids normal », « surpoids » ou « obésité ».
Bien que l’IMC en tant qu’indicateur de santé fiable soit régulièrement sous le feu des critiques, dans la pratique, il se révèle être un indicateur utile pour déterminer l’état de santé général d’une population en lien avec le poids (prévalence totale), notamment dans le cadre d’études longitudinales telles que le monitoring de Promotion Santé Suisse. À l’échelle de la population, l’IMC permet de suivre les tendances et de mettre en lumière les différences entre régions, groupes d’âge ou contextes sociaux.
Au niveau individuel, par contre, l’IMC n’a qu’une valeur indicative limitée. Il ne tient compte ni de la composition corporelle (masse musculaire vs masse graisseuse) ni du développement physique. L’IMC peut notamment conduire à des interprétations erronées chez les adolescent-e-s en pleine croissance. Les aspects psychosociaux tels que l’image corporelle, l’estime de soi ou les comportements alimentaires ne sont pas non plus pris en compte.
Promotion Santé Suisse utilise donc l’IMC avec circonspection et l’applique dans le cadre d’une étude longitudinale et non comme un outil de diagnostic individuel. Il est fondamental de rappeler qu’être en bonne santé va bien au-delà d’avoir un poids « normal ». Une promotion de la santé globale tient également compte de la santé psychique, de l’image corporelle et du contexte socioéconomique.
Qu’est-ce qui marche et où faut-il de nouvelles approches?
Actuellement, tous les 26 cantons mettent en œuvre des programmes d’action cantonaux (PAC) visant à promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante chez les enfants et les adolescent-e-s. Au cours des dernières années, ces programmes se sont imposés comme des instruments efficaces de promotion de la santé et sont aujourd’hui considérés comme des modèles de bonnes pratiques.
La tendance positive observée aux niveaux scolaires inférieurs le prouve : la proportion d’enfants en surpoids est en baisse tant à l’école enfantine qu’à l’école primaire. De nombreux éléments laissent à penser que les mesures déployées à ce jour sont efficaces, en particulier lorsqu’elles combinent les thèmes alimentation équilibrée, activité physique suffisante et création d’un environnement favorable.
Le besoin d’intervention reste pourtant élevé, surtout au niveau des 2e et 3e cycles où les chiffres stagnent ou repartent à la hausse. De nouvelles approches sont nécessaires pour atteindre les adolescent-e-s dans leur réalité quotidienne et intégrer l’évolution de leurs habitudes comportementales (p. ex. utilisation croissante des médias sociaux). Accroître la participation, utiliser l’approche par les pair-e-s et procéder à des interventions structurelles sont autant de pistes intéressantes.
Pourquoi le surpoids touche-t-il majoritairement les enfants issu-e-s de familles socioéconomiquement défavorisées?
Le risque de surpoids est étroitement lié aux conditions de vie des enfants et des familles. Ainsi, les enfants de parents sans formation post-obligatoire sont trois fois plus souvent en surpoids que ceux/celles dont les parents ont un diplôme du degré supérieur. Chez les élèves de nationalité étrangère, la prévalence de surpoids est également nettement plus élevée (24%) que chez leurs camarades suisses (14,2%). Diverses études nationales et internationales (voir p. ex. Berli, Sempach et Herter-Aeberli, 2024 ; Eiholzer, Fritz et Stephan, 2021 ; Mech et al., 2016 ; Paalanen et al., 2022 ; Rakić et al., 2024) soulignent régulièrement l’importance de l’origine sociale et des désavantages ou privilèges socioéconomiques dans le risque de surpoids.
Ces différences ne peuvent être réduites à des caractéristiques individuelles telles que le niveau d’éducation ou l’origine, mais reflètent plutôt une réalité complexe aux causalités multiples : des difficultés financières, un espace de vie réduit, des possibilités restreintes de pratiquer une activité physique dans le quartier ou encore une consommation de médias élevée exercent une influence négative sur les comportements en matière d’alimentation et d’activité physique. À cela s’ajoute que les parents en situation précaire ont souvent un moindre accès aux connaissances et aux offres de promotion de la santé et disposent de ressources réduites pour les mettre en œuvre.
Le rapport de base sur l’égalité des chances dans la promotion de la santé et la prévention en Suisse de Promotion Santé Suisse expose clairement que les différences sociales dans le domaine de la santé ne sont pas un problème individuel, mais bien l’expression d’inégalités structurelles. C’est pourquoi les mesures de promotion de la santé ne suffisent pas à elles seules. Une prévention efficace doit également s’inscrire dans les domaines politique, éducatif, social et public, et créer des conditions-cadres permettant à chaque enfant de grandir en bonne santé. Promotion Santé Suisse s’engage donc en faveur d’une promotion de la santé équitable, qui tienne compte de toutes les phases et situations de vie.
Quel est le lien entre image corporelle et IMC?
Être en bonne santé ne se résume pas à avoir un IMC « normal ». Pour les enfants et les adolescent-e-s, l’image corporelle joue un rôle central non seulement pour la santé, mais aussi l’identité, l’estime de soi et le sentiment d’appartenance.
La perception que les enfants et les adolescent-e-s ont de leur propre corps est fortement influencée par les idéaux de beauté en vigueur dans la société. Ainsi, dans notre culture, être mince, sportif-ve, beau/belle et performant-e est considéré comme positif, tandis que le surpoids est souvent associé à la paresse, au manque de discipline ou à l’échec. Ces stéréotypes ont un impact sur les deux sexes, mais sous des formes différentes.
Les filles s’orientent souvent vers l’idéal de minceur et de perfection, tandis que les garçons ambitionnent plutôt d’avoir un corps musclé. Cette aspiration peut s’avérer problématique lorsqu’associée à un entraînement excessif ou à la consommation de substances améliorant les performances. Bien que ces tendances ne concernent pas tout le monde, les chercheur-euse-s observent de plus en plus de cas où le désir d’avoir un corps « parfait » conduit à des comportements nuisibles à la santé.
La consommation de réseaux sociaux représente un autre facteur d’influence : dans le monde virtuel, les adolescent-e-s sont quotidiennement confronté-e-s à des images corporelles idéalisées, sans avoir toujours conscience que de nombreuses photos ont été fortement retouchées. C’est pourquoi il est fondamental de promouvoir les compétences numériques : les adolescent-e-s doivent être capables d’adopter un regard critique sur la manière dont les images sont créées et les attentes irréalistes qu’elles génèrent.
La perception du surpoids dans la société n’a guère évolué : en règle générale, celui-ci est rarement associé à la confiance en soi, à la réussite ou à l’attractivité. Il est ainsi essentiel de promouvoir une conception plus large de la santé, au-delà des chiffres sur la balance et des normes de beauté.
À cette fin, Promotion Santé Suisse soutient des projets visant à renforcer une image corporelle positive et s’engage en faveur d’une culture où la diversité, l’acceptation de soi et la santé psychique sont également considérées. La plateforme healthybodyimage.ch, par exemple, propose des informations et des ressources concrètes pour les adolescent-e-s, les parents et les professionnel-le-s.
Que fait Promotion Santé Suisse pour influencer l’IMC?
La Fondation s’engage à créer des conditions-cadres qui favorisent une alimentation équilibrée et une activité physique suffisante chez les enfants et les adolescent-e-s. Il est en effet prouvé que ces deux facteurs contribuent à un poids corporel sain et exercent ainsi une influence positive sur l’évolution à long terme de l’IMC dans la population.
Les programmes d’action cantonaux (PAC), actuellement mis en œuvre dans les 26 cantons, constituent un instrument central à cet égard. Ils aident notamment les écoles, les crèches, les communes ou les quartiers à créer des conditions de vie favorables à la santé, par exemple par le biais d’espaces extérieurs propices à l’activité physique, de repas scolaires sains ou d’offres destinées aux familles.
Quelques exemples de mesures concrètes :
- Le projet « Youp’là bouge », qui intègre très tôt l’activité physique et une alimentation équilibrée dans le quotidien des crèches et des écoles. Les professionnel-le-s sont formé-e-s et les espaces aménagés en conséquence afin de permettre davantage d’activité physique au quotidien.
- L’offre « Femmes-Tische / Männer-Tische », qui s’adresse également aux parents, en particulier ceux issus de groupes socialement défavorisés. Lors de tables rondes encadrées par un-e animateur-trice, les participant-e-s échangent sur un pied d’égalité leurs connaissances et expériences ainsi que des conseils pratiques sur la santé, l’alimentation, l’activité physique et l’éducation.
Promotion Santé Suisse soutient également des projets qui visent à promouvoir une image corporelle positive, tels que PEP – gemeinsam essen ou la plateforme healthybodyimage.ch. En effet, les personnes qui développent une relation saine avec leur propre corps sont plus enclines à prendre des décisions susceptibles de renforcer leur bien-être physique et psychique.
Il est important de noter que Promotion Santé Suisse ne poursuit pas l’objectif d’agir sur l’IMC des individus. Il s’agit plutôt de créer des structures adéquates et durables qui offrent aux enfants et aux adolescent-e-s la chance de se développer sainement, indépendamment de leur extraction sociale ou situation de vie.
Outre le monitoring de l’IMC, existe-t-il d’autres études sur le sujet?
Au niveau suisse, Herter-Aeberli (2024) a mesuré l’IMC d’enfants âgé-e-s de 6 à 12 ans pour le compte de l’OFSP. Pour une comparaison internationale, il convient de se référer à l’étude de l’OMS (2024), qui a analysé les données relatives au poids corporel d’enfants âgé-e-s de 7 à 9 ans dans 40 pays européens.
Recommandations pour une communication visuelle respectueuse
Une communication responsable et respectueuse sur le thème du surpoids et de l’obésité chez les enfants et les adolescent-e-s doit non seulement transmettre des informations factuelles, mais aussi soigner son langage visuel. Les images influencent la perception, surtout lorsqu’il s’agit de sujets sensibles tels que le poids, l’image corporelle ou la santé. Les images créées à l’aide de l’intelligence artificielle nécessitent une attention particulière.
Promotion Santé Suisse formule ainsi les recommandations suivantes à l’attention des professionnel-le-s de la communication et des médias:
Éviter les représentations stigmatisantes : ne pas montrer les enfants et les adolescent-e-s isolé-e-s, de dos ou dans des situations problématiques (p. ex. en mettant l’accent sur certaines parties du corps, en utilisant des angles de vue défavorables ou en les associant à des aliments malsains).
- Valoriser la diversité : utiliser des images qui mettent en évidence la diversité en termes de morphologie, d’origine, d’âge, de sexe et de capacités.
- Mettre en avant le bien-être plutôt que des aspects négatifs : en lieu et place de messages moralisateurs, miser sur des images positives qui illustrent le plaisir de manger et de bouger, des moments de la vie quotidienne favorables à la santé ou exprimant la participation sociale.
- Éviter de représenter des idéaux de beauté normatifs : renoncer aux représentations idéalisées, retouchées ou scénarisées et privilégier les personnes réelles dans des situations réelles.
- Les images générées par l’IA ont tendance à reproduire les idéaux physiques et esthétiques en vigueur dans notre société. Il s’agit de vérifier soigneusement que ces images préservent la diversité, le naturel et l’inclusion.